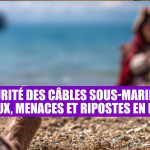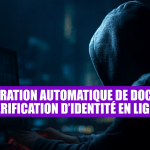Depuis 2023, la multiplication d’incidents sous-marins a conduit les pays européens et les membres du dialogue quadrilatéral pour la sécurité à renforcer massivement leur surveillance et leurs capacités militaires en mer, afin de protéger une infrastructure numérique et énergétique jusqu’alors négligée : les câbles sous-marins, les pipelines et les terminaux d’énergie.
Sous la surface, une infrastructure vitale et vulnérable
CTI ZATAZ – Scannez les menaces vous concernant avant qu’il ne soit trop tard.
Confidentiel. Instantané. Sécurisé. Zéro intermédiaire. 100 % Made in France.
La privatisation de la résilience, enjeu critique pour les États
La quasi-totalité des infrastructures de câbles sous-marins appartient à des acteurs privés, tels que Google, Microsoft, Orange ou BT Group, qui investissent dans la pose et l’entretien des réseaux. Néanmoins, la responsabilité de la sécurité et de la résilience de ces infrastructures relève de l’intérêt public. « En 2022, la rupture d’un câble reliant l’archipel britannique des Shetland a plongé toute la région dans un isolement numérique de plus de 24 heures, faute de solution de repli prévue entre les opérateurs et le gouvernement. » Ce type d’événement souligne la fragilité d’une gestion exclusivement privée de réseaux essentiels.
À l’inverse, la Norvège a mis en place, en partenariat entre l’opérateur Telenor et les forces armées norvégiennes, un système de surveillance autour de ses terminaux côtiers. Lorsqu’une coupure a affecté la connexion de l’archipel du Svalbard en 2022, la réaction des autorités a permis une restauration partielle du service en quelques heures, démontrant l’efficacité d’une coordination public-privé renforcée.
Le défi de la surveillance et de la réaction rapide est d’autant plus grand que l’infrastructure a été conçue historiquement sans objectif de sécurité. Les protocoles de surveillance et d’intervention sont donc limités et très hétérogènes selon les pays. « En Europe, la fragmentation des responsabilités entre États, entreprises et agences rend la coordination difficile, contrairement à Singapour, où la sécurité des câbles est intégrée à la planification de la défense nationale », constate un rapport du Centre européen de cybersécurité.
La capacité de réparation reste également limitée. Dès lors qu’une rupture ou une attaque est détectée, le déploiement d’une mission de réparation exige l’envoi de navires spécialisés, parfois mobilisables seulement après plusieurs jours, voire semaines. Cette latence expose les sociétés et économies concernées à des interruptions de services critiques, de la transmission bancaire au fonctionnement des ports et hôpitaux.
« À chaque incident sous-marin, les pertes financières sont estimées à plusieurs millions d’euros, sans compter les coûts indirects pour la sécurité nationale », précise un rapport parlementaire allemand de 2024. De plus, l’absence de plan de secours unifié entre les opérateurs privés et les autorités publiques aggrave l’impact de ces ruptures accidentelles ou malveillantes.
Les perspectives de protection reposent aujourd’hui sur une réévaluation de la notion de frontière et de souveraineté. Plusieurs gouvernements européens recommandent d’intégrer le plancher océanique à la stratégie de défense nationale, au même titre que le territoire aérien ou terrestre. Le développement de capteurs sous-marins, la mise en place de brigades spécialisées dans la réparation d’urgence et le renforcement des partenariats public-privé constituent les axes majeurs de réflexion en cours.
Les conséquences d’une attaque ou d’une défaillance d’un câble privé deviennent immédiatement un problème d’État. L’approche purement sectorielle n’est plus adaptée à la réalité de la menace. Cette réalité s’impose d’autant plus que, désormais, la géopolitique remplace la profondeur des fonds marins comme critère principal d’évaluation du risque.
Les incidents récents démontrent que la prochaine crise internationale majeure pourrait ne pas se jouer dans l’espace ou le cyberespace, mais à deux mille mètres sous l’eau. Ce déplacement de la conflictualité impose aux acteurs publics et privés une vigilance et une coopération de tous les instants pour prévenir la désorganisation potentielle des sociétés modernes.
La sécurisation de ces infrastructures devient un enjeu stratégique majeur, au carrefour de la cybersécurité, de la sécurité énergétique et de la souveraineté des États. Le rapport annuel de l’Agence européenne de la cybersécurité souligne la nécessité d’élaborer des normes communes et d’établir un dispositif d’alerte rapide partagé par tous les pays membres.
La multiplication des drones sous-marins, l’intégration de capteurs de surveillance en temps réel et la création d’équipes mixtes d’intervention figurent parmi les réponses techniques explorées. Néanmoins, ces mesures requièrent des investissements lourds, une coordination transnationale accrue et une évolution des législations existantes sur la sécurité des réseaux critiques.
Bref ! Vous allez regarder la plage et la mer d’un autre œil !
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Aucun spam – Désinscription en un clic – Vie privée respectée