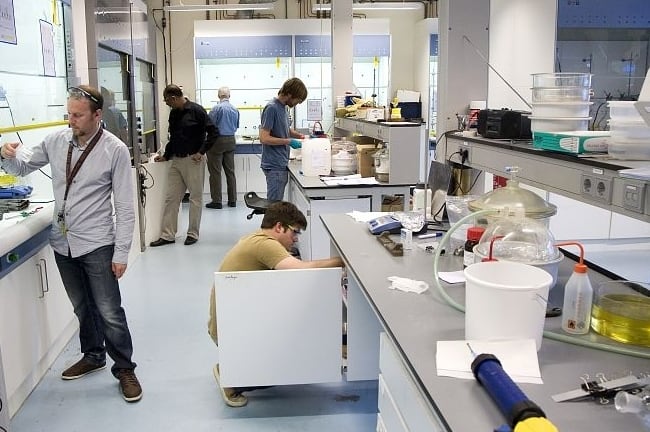
Pensée comme un levier de compétitivité scientifique, industrielle et de souveraineté, la loi de programmation de la recherche (LPR) devait réarmer durablement la recherche française. Cinq ans après son adoption, sa trajectoire budgétaire apparaît de plus en plus fragilisée par les contraintes financières de l’État.
Adoptée fin 2020, la loi de programmation recherche (LPR) promettait 25 milliards d’euros supplémentaires sur dix ans afin de combler le retard français en matière de recherche et développement (R&D), d’améliorer l’attractivité des carrières scientifiques et de renforcer les liens entre recherche publique et industrie. Pour sécuriser cette trajectoire, le législateur avait prévu une «clause de revoyure» tous les trois ans. Celle-ci devait permettre d’ajuster les moyens au regard de la conjoncture économique et des besoins du système de recherche. Or, malgré une consultation organisée le 19 mars 2025 par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, celle-ci n’a jamais été formellement enclenchée.
Une «sous-exécution» depuis trois ans
«Nous n’avons eu aucune information depuis le lancement de cette consultation. Le sujet semble être devenu secondaire, éclipsé par la crise budgétaire», déplore Boris Gralak, directeur de recherche au CNRS et secrétaire général du Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU). Du côté du ministère, une source temporise : «Par rapport à d’autres lois de programmation qui sont totalement gelées, la LPR n’est pas la plus mal lotie.» Près de 4 milliards d’euros ont en effet été versés depuis 2021, notamment en faveur des chercheurs et enseignants-chercheurs.
Mais cette même source reconnaît une «sous-exécution» persistante depuis trois ans. «L’an dernier, nous avons progressé d’une demi-marche. Cette année, ce sera plutôt un tiers», concède-t-elle. Un constat jugé très insuffisant par l’astrophysicienne Françoise Combes, présidente de l’Académie des sciences. «La LPR devait enrayer le décrochage français. En réalité, on est en train de l’accentuer. Pendant que d’autres pays investissent massivement, nous rabotons les budgets, y compris ceux de l’investissement scientifique et immobilier», alerte-t-elle, assurant qu’«un euro investi dans l’université rapporte quatre euros à l’économie».
Revalorisations salariales menacées
Jusqu’à présent, les revalorisations salariales constituaient l’un des piliers relativement préservés de la LPR. Elles sont désormais directement menacées. Faute de marges budgétaires, près de 49000 enseignants-chercheurs et 17000 chercheurs pourraient ne bénéficier d’aucune augmentation de primes, tandis que les promotions prévues par l’accord de 2020 seraient suspendues.
Selon les organisations syndicales, il manque aujourd’hui plus de 300 millions d’euros par an pour respecter la trajectoire initiale de la loi, notamment en matière de convergence des primes avec la moyenne interministérielle et de «repyramidage» des carrières universitaires, avec un objectif affiché de 40% de professeurs d’ici 2030.
«Le repyramidage vise à corriger des blocages structurels, en particulier pour les maîtres de conférences bloqués depuis parfois plus de dix ans, et à réduire les inégalités, notamment de genre, dans l’accès au corps des professeurs», rappelle Jérôme Giordano, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et chargé de mission au SNPTES-Unsa. Entre 2020 et 2024, la part de professeurs d’université est ainsi passée de 31,9% à 35,4%, une dynamique aujourd’hui menacée.
Au-delà des rémunérations, les établissements publics de recherche font face à un choc budgétaire brutal lié à l’accumulation de charges non compensées. Au CNRS, la situation illustre cette tension. Baisse des subventions votées, hausse des cotisations retraite, glissement vieillesse technicité (GVT), mesures salariales et protection sociale complémentaire représentent environ 450 millions d’euros sur 2025 et 2026. «Pour 2026, nous avons fait voter un budget initial en déficit de 239 millions d’euros. Nous l’absorbons grâce à notre trésorerie, mais ce n’est pas soutenable à moyen terme et cela ne pourra pas être renouvelé», alerte Antoine Petit, président-directeur général du CNRS.
Une inquiétude partagée par l’industrie
Relativement épargnés par les coupes budgétaires directes, les industriels s’inquiètent néanmoins de la fragilisation de l’écosystème de recherche. «Tous les pays qui réussissent ont une recherche publique forte. Le privé en dépend directement», insiste Marko Erman, directeur scientifique de Thales. Le groupe, qui emploie 33500 personnes en R&D, s’appuie sur un réseau dense de collaborations académiques, notamment avec le CNRS, l’Inria et le CEA. Symbole de cet affaiblissement, la France forme deux fois moins de docteurs que l’Allemagne, et le doctorat y reste un ascenseur social incertain, en particulier dans les filières scientifiques et technologiques.
Dans ce contexte, la remise en question du crédit d’impôt recherche (CIR), qui représente près de 8 milliards d’euros par an, refait surface. «C’est un dispositif opaque, dont l’efficacité est discutable. Une partie de l’argent public est détournée vers des usages sans lien direct avec la recherche», critique Julien Diaz, directeur de recherche à l’Inria et secrétaire général adjoint du SNCS-FSU, qui plaide pour sa suppression ou sa refonte.
Une chose est certaine : l’un des objectifs phares de la LPR — porter l’effort national de recherche à 3% du PIB — reste hors de portée. En 2024, la dépense intérieure de R&D stagnait à 2,18% du PIB, en recul par rapport à 2022. Une trajectoire qui interroge la capacité de la France à tenir ses ambitions scientifiques et industrielles à long terme.






