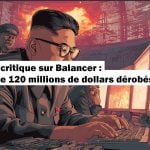Augmentation constante de la consommation
Augmentation constante de la consommation
Le but était de protester contre une subvention, versée par l’éco-organisme de la filière, Refashion, jugée trop faible par Le Relais. Le gouvernement a depuis fait un geste en direction de la filière. Mais les causes profonde de la crise, plus structurelles, demeurent : saturation des stocks chez les acteurs de seconde main, omniprésence de vêtements de mauvaise qualité et/ou en polyester, qui disposent de moins de solutions pour leur fin de vie, et réduction des débouchés à l’export, particulièrement sur le continent africain.
Il faut dire qu’en 2024, 3,5 milliards de pièces neuves ont été mises sur le marché en France, d’après le baromètre de Refashion. Soit un milliard de plus qu’il y a 10 ans, selon le rapport rédigé par la députée Anne-Cécile Violland, qui portait la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile.
Un modèle basé sur l’obsolescence émotionnelle
Un modèle basé sur l’obsolescence émotionnelle
Selon un rapport publié par les ONG Actionaid et China Labor Watch, intitulé «Shein : la mode qui va vite et qui fait mal», la marque chinoise «commande en flux tendu à une constellation de petits fournisseurs chinois, à qui il est demandé de produire en très faibles quantités. Selon la demande, l’offre s’adapte en permanence aux préférences des consommateur·rices». Un modèle de production «à la demande» qui «permet d’éliminer la plupart des invendus, des stocks inutiles et de répercuter ces économies sur les consommateurs en offrant un bon rapport qualité-prix», selon Donald Tang, président de Shein, interrogé par la chaîne étasunienne CNBC lors du forum économique de Davos. Mais si la production est bien basée sur la demande, Shein influe sur celle-ci par un «renouvellement permanent de l’offre, fondé sur l’obsolescence émotionnelle». Cela fait en sorte que les vêtements achetés la veille sont déjà démodés, et doivent ainsi être remplacés. De plus, les conditions de travail des ouvriers qui triment au sein des sous-traitants de la marque chinoise sont extrêmement mauvaises : travail non-rémunéré des femmes dans certains ateliers, habitats insalubres, l’absence de règles de sécurité et d’équipements de protection, entre autres.
Une réduction des volumes nécessaire ?
Une réduction des volumes nécessaire ?
Les ONG rappellent cependant que Shein n’est que l’héritier d’un «système déjà bien rodé par des marques comme Zara ou H&M, ayant ouvert la voie à une production massive et accélérée». Pour Julia Faure, fondatrice de la marque Loom, «ce n’est pas uniquement Shein qu’il faut freiner. C’est tout le modèle de la fast fashion qu’il faut réguler ». En Mode Climat, association d’acteurs du textile qui appellent à une législation plus contraignante pour le secteur en termes de réduction des émissions de CO2, dont Julia Faure est la présidente, a publié en juillet 2025 une note concernant la refonte de la filière à responsabilité élargie du producteur textile, qui est en cours de concertation pour la révision de son cahier des charges.
L’association appelle à «favoriser une approche préventive, qui passe notamment par la stabilisation puis réduction des mises sur le marchés, pour éviter, entre autres, le gaspillage (social, environnemental, économique) que constituerait une explosion des quantités de textile incinérés.» Elle propose en outre à adopter des objectifs chiffrés basés sur la mise en marché et le taux de substitution des achats neufs par les achats de seconde main ou les actes de réparation. Elle suggère aussi de ne pas laisser le pilotage des écomodulations à Refashion, dont le conseil d’administration est composé «notamment des marques de fast fashion et low-cost», ce qui constituerait un conflit d’intérêt, aux yeux de l’association. Enfin, elle appelle à faire appliquer le principe du pollueur-payeur au sein de la filière. Ces mesures seraient nécessaires, selon En Mode Climat, pour éviter une accélération de la désindustrialisation du secteur textile, et l’augmentation du déficit commercial, qui s’établit déjà à -8,5 milliards d’euros pour le textile d’habillement en 2023.